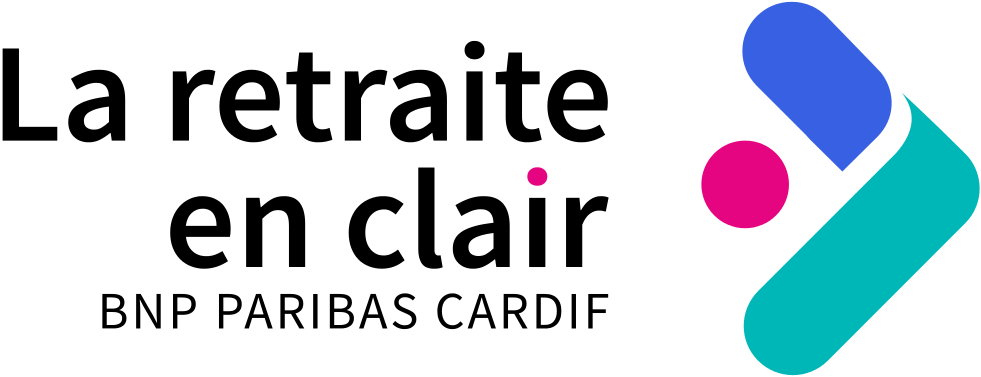La retraite des instituteurs et des professeurs des écoles dans la fonction publique
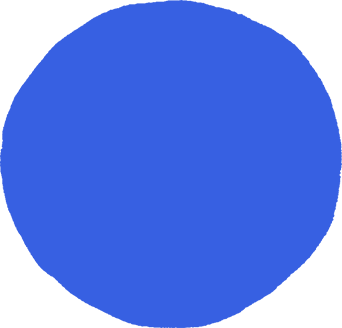
2 620 €
Montant de la pension moyenne des enseignants du 1er degré en 2023
Si, dans le langage courant, professeur des écoles et instituteurs se confondent, ces termes ne renvoient pas à la même réalité dans le langage administratif. Il est important de les distinguer, car vos droits changent selon votre statut et cela a un impact sur votre retraite. Décryptage.Si, dans le langage courant, professeur des écoles et instituteurs se confondent, ces termes ne renvoient pas à la même réalité dans le langage administratif. Il est important de les distinguer, car vos droits changent selon votre statut et cela a un impact sur votre retraite. Décryptage.
Source : Bilan social du ministère de l’Éducation nationale (2022-2023)
Instituteur et professeur des écoles : quelles différences ?
Le professeur des écoles a suivi une formation dans un Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM — ils ont existé de 1990 à 2013), dans un Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé, ils existent depuis 2013) ou bien à l’université (bac +5).
L’instituteur, lui, a suivi une formation dans une école normale. Cette institution n’existe plus depuis 1989 et les instituteurs en activité sont progressivement devenus professeurs des écoles, sur acte de candidature (en 2024, seule une poignée d’enseignants du primaire exerce encore sous le statut d’instituteur).
Avant 1989, un enseignant en école primaire était donc un instituteur. Depuis 1989, c’est un professeur des écoles (sauf si l’instituteur est resté sous son statut, ce qui est rare).
Dans le langage courant, les 2 termes se confondent. Il est néanmoins important de les dissocier, car le fait d’avoir été instituteur donne certains droits par rapport aux professeurs des écoles qui se sont formés en IUFM, Inspé ou à l’université.
| Instituteur | Professeur des écoles | |
|---|---|---|
| Formation | École normale | IUFM (jusqu’en 2013) puis Inspé ou bac +5 |
| Date du statut | Jusqu’en 1989 | Depuis 1989 |
Instituteur et professeur des écoles : âge de départ à la retraite
Depuis le 1ᵉʳ septembre 2023, les instituteurs et professeurs des écoles ont le droit de partir à la retraite pendant l’année scolaire. Ce n’était pas le cas auparavant : ils devaient s’aligner sur l’année scolaire pour liquider leur pension (sauf situations exceptionnelles).
Si un professeur des écoles ou un instituteur atteint la limite d’âge (62 à 67 ans) en cours d’année, il peut demander à rester en activité jusqu’à la fin de l’année scolaire. La limite d’âge correspond à la mise à la retraite d’office. Pour augmenter le montant de votre pension de retraite, il est possible de repousser cette limite de 3 ans maximum, sous certaines conditions : maintien dans l’intérêt du service, enfants à charge…
Âge de départ à la retraite des instituteurs et ex-instituteurs
Un instituteur doit partir à la retraite à 62 ans au plus tard (contre 67 ans pour un professeur des écoles). Il bénéficie alors d’une retraite à taux pleinTaux plein<p>Taux maximum de calcul d'une retraite dont peut bénéficier l'assuré dans tous les régimes. Pour prétendre à une pension de retraite à taux plein, il faut remplir des conditions d'âge et de durée d'assurance.</p>.
Un ex-instituteur devenu professeur des écoles doit partir à l’âge de 67 ans au plus tard. Il conserve néanmoins la possibilité d’obtenir une retraite à taux plein à l’âge de 62 ans, s’il en fait la demande et s’il a accompli au moins 15 à 17 ans de services actifs (15 ans s’il a atteint cette durée de services actifs avant le 1er juillet 2011 et 17 ans s’il a atteint cette durée à compter de 2015). S’il souhaite travailler au-delà de 62 ans, il peut obtenir une surcoteSurcote<p>Majoration appliquée au montant de la pension d'un assuré ayant atteint l'âge légal de départ en retraite et qui a continué à travailler au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein.</p> de sa pension de retraite.
En service actif est un emploi qui présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Comptent comme services actifs :
- les années d’enseignement en tant qu’instituteur (ce qui n’est pas le cas des années d’enseignement en tant que professeur des écoles) ;
- les périodes de scolarité passées à l’école normale à partir de 18 ans, en tant qu’élève-maître (agents titularisés en qualité d’instituteurs) ;
- les périodes de scolarité passées à l’école normale avant 18 ans, en tant que stagiaire (formation professionnelle) ;
- certaines périodes de services en tant qu’instituteur détaché (détail des périodes disponibles dans la brochure du service des retraites de l’éducation nationale) ;
- les congés de maladie et les congés de maternité ;
- les services à temps partiel accomplis à partir du 28 décembre 1980 ;
- les emplois reconnus comme tels dans les autres administrations de l’État (facteur, policier…).
Âge de départ à la retraite pour les professeurs des écoles
Les professeurs des écoles qui n’ont jamais été instituteurs peuvent partir à l’âge légal de départ à la retraite compris entre 62 ans et 64 ans, selon leur année de naissance. Pour le taux plein, ils doivent attendre 67 ans.
Instituteur et professeur des écoles : montant de votre retraite de base
La formule de calcul du montant de la retraite d’un instituteur ou d’un professeur des écoles comprend plusieurs éléments :
- Le traitement indiciaire : c’est votre revenu en tant que fonctionnaire, sur votre dernier emploi détenu pendant au moins 6 mois ;
- Le nombre de trimestres : c’est la durée pendant laquelle vous avez travaillé en tant que fonctionnaire. 1 trimestre est égal à 45 jours de services. Il n’est pas possible d’en acquérir plus de 4 par an. Des trimestres supplémentaires peuvent s’ajouter à travers les bonifications
Bonification<p>Terme utilisé dans la fonction publique pour désigner les trimestres complémentaires accordés aux fonctionnaires au titre de services accomplis ou de leur situation familiale, afin d'augmenter le montant de leur pension.</p> (si vous avez eu un enfant avant le 1er janvier 2004 et que vous avez interrompu votre activité pendant au moins 2 mois ou que vous êtes passé à temps partiel, par exemple) ;
- Le taux maximal : il est de 75 % et peut être porté à 80 % grâce à certaines bonifications (sauf pour les instituteurs, il reste à 75 %) ;
- Le nombre de trimestres requis pour atteindre le taux maximal : il dépend de votre année de naissance et de votre statut.
Et éventuellement :
- une décote
Décote<p>Réduction définitive appliquée au montant de la pension d'un assuré. Elle s'applique lorsque l'assuré choisit de partir à la retraite alors qu'il n'a pas atteint la durée de cotisation requise pour percevoir une retraite à taux plein.</p> sur le montant de la pension de 1,25 % par trimestre manquant pour le taux plein (dans la limite de 20 trimestres) ;
- une surcote
Surcote<p>Majoration appliquée au montant de la pension d'un assuré ayant atteint l'âge légal de départ en retraite et qui a continué à travailler au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein.</p> sur le montant de la pension de 1,25 % par trimestre supplémentaire de cotisation (il n’y a aucune limite de trimestres supplémentaires) ;
- une majoration
Majoration<p>Avantage supplémentaire en matière de retraite lié à la situation personnelle de la personne (ex : majoration de la pension de retraite pour enfants).</p> de 10 % du montant de la pension, si vous avez élevé au moins 3 enfants (et 5 % en plus par enfant supplémentaire, tant que votre pension majorée ne dépasse pas le montant de votre dernier traitement indiciaire brut détenu depuis au moins 6 mois).
| Année de naissance | Nombre de trimestres requis pour le taux plein (professeurs des écoles) |
|---|---|
| 1960 | 167 |
| 1er janvier 1961 au 31 août 1961 | 168 |
| 1er septembre 1961 au 31 décembre 1962 | 169 |
| 1963 | 170 |
| 1964 | 171 |
| 1965 et après | 172 |
| Année de naissance | Nombre de trimestres requis pour le taux plein (instituteurs et professeurs des écoles ayant choisi la limite d’âge des instituteurs) |
|---|---|
| 1er novembre 1958 au 31 décembre 1960 | 166 |
| 1961, 1962, 1963 | 167 |
| 1964, 1965, 1966 | 168 |
| 1er septembre 1966 au 31 décembre 1967 | 169 |
| 1968 | 170 |
| 1969 | 171 |
| 1970 et après | 172 |
La formule de calcul est la suivante :
Montant de la pension = dernier traitement indiciaire brut x (nombre de trimestres rémunérés dans la pension / nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite au taux maximal) x 75 %.
Il existe un minimum garanti du montant de la pension de retraite. Il varie selon le nombre d’années de services. En 2024, il ne peut pas porter la somme totale des pensions de retraite au-delà de 1 325,01 € par mois.
La retraite complémentaire des instituteurs et professeurs des écoles
Depuis 2005, les instituteurs et professeurs des écoles cotisent auprès du Régime additionnel de la fonction publique (RAFP). C’est un régime obligatoire, par pointsRégime de retraite par points<p>Régime dans lequel le montant de la retraite est calculé en points. Le nombre de points acquis est fonction des cotisations de l'assuré, et le montant de la retraite se calcule en multipliant le nombre de points acquis par la valeur du point.</p>. Avant 2005, il n’y avait pas de retraite complémentaire pour les agents de la fonction publique.
Chaque mois, les instituteurs ou professeurs des écoles versent une cotisation de 5 % (leur employeur aussi) à la RAFP, sur la base des primes et des éléments de rémunération qui s’ajoutent au traitement de base (heures supplémentaires, avantages en nature…). Ces cotisations se transforment en points, qui servent ensuite au calcul de la pension additionnelle.
Vous pouvez demander le versement de votre pension de retraite additionnelle uniquement après la liquidation de votre retraite de base, c’est-à-dire à un âge compris entre 62 ans et 64 ans (selon votre année de naissance). Selon votre nombre de points, elle est versée en 1 fois (capital) ou bien chaque mois en une plus petite somme (rente). Au-delà de 62 ans, un coefficient de majoration est appliqué à votre pension (en 2024, il va de 1,04 si vous partez à 63 ans jusqu’à 1,80 si vous partez à 75 ans ou après).
En 2022, la rente moyenne est de 397 € et le capital moyen de 3 776 €, selon le rapport annuel de l’ERAFP (organisme qui gère la RAFP).
La retraite complémentaire des fonctionnaires titulaires
La retraite des instituteurs et professeurs des écoles : les démarches
Voici les démarches à suivre tout au long de votre carrière :
- en début de carrière : inscrivez-vous sur ensap.gouv.fr (espace numérique sécurisé de l’agent public) ;
- 35 ans : vous recevez le relevé de situation individuelle, qui est ensuite renvoyé tous les 5 ans ;
- 45 ans : vous pouvez simuler votre future pension sur ensap.gouv.fr ;
- 53 ans : votre service des ressources humaines vous contacte pour vérifier l’exactitude des données enregistrées sur ensap.gouv.fr ;
- 55 ans : vous recevez une estimation indicative globale de votre pension ;
- à 2 ans de la retraite : vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé du service des retraites de l’État en appelant le 02.40.08.87.65 ou via le formulaire en ligne sur retraitesdeletat.gouv.fr ;
- 6 mois avant votre départ à la retraite : vous devez en faire la demande sur ensap.gouv.fr ou bien sur info-retraite.fr et informer votre directeur académique.
Vous avez exercé un autre métier avant d’être professeur des écoles (ou après) ? Découvrez notre article sur la retraite des polypensionnés.
Laissez nous votre avis !
A la une
Les plus lus
A découvrir aussi