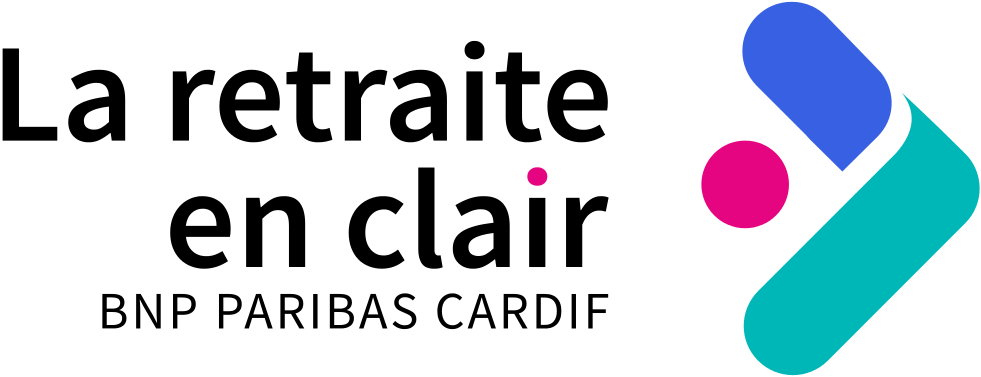Les retraites des agriculteurs : ce que les dernières réformes ont changé
Depuis sa création en 1952, le régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles a connu un certain nombre de réformes : la reconnaissance du statut de conjoint collaborateur en 1999, la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en 2002 et l’extension à l’ensemble des non-salariés agricoles en 2011. Depuis 2014, de nouvelles réformes ont porté sur les droits familiaux, l’assouplissement de l’affiliation et la possibilité de revaloriser les pensions, ou bien la revalorisation des pensions en outre-mer.
Les agriculteurs et la réforme de 2014
La réforme des retraites de 2014 a en partie concerné les agriculteurs. 3 décrets publiés le 17 mai 2014 ont précisé certaines modifications apportées par la loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014.
Mise en place de points gratuits de retraite complémentaire
Un 1er décret a permis aux conjoints et aidants familiaux de bénéficier de points gratuits de retraite complémentaireRégime de retraite complémentaire<p>Régime de retraite dont les prestations s'ajoutent à celles du régime de base (ex : régime Agirc-Arrco pour les salariés cadres et non-cadres, régime Ircantec pour les agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, etc.).</p> (sans contrepartie de cotisations) pour la période antérieure à 2011 (même s'ils étaient déjà à la retraite).
La durée minimale d'assurance au régime des non-salariés agricoles requise pour l'ouverture de droit a été fixée à 17,5 ans. Cette mesure ne concerne pas les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997, qui devaient avoir été affiliées pendant 32,5 ans. Le nombre maximal d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points a été fixé à 17 et le nombre de pointsPoint de retraite<p>Les cotisations d'un assuré lui permettent d'acquérir des points retraite dans certains régimes, comme le régime complémentaire Agirc-Arrco. Le montant de sa retraite est égal au total des points acquis pendant sa vie professionnelle, multipliée par la valeur du point lors de son départ en retraite.</p> attribuables par an à 66.
Cette mesure a représenté une augmentation de la pension allant jusqu'à 30 € / mois par personne et a concerné plus de 500 000 personnes.
Mise en place de « droits combinés » pour la retraite complémentaire
Ce même décret a précisé les conditions dans lesquelles, en cas de décès d'un agriculteur, son conjoint survivant, s’il décidait de reprendre l'exploitation, pouvait désormais ajouter aux siens les points de retraite complémentaire du défunt. Ce mécanisme, qu'on appelle les « droits combinés », n'existait avant la loi de 2014 que pour la retraite de baseRégime de retraite de base<p>Premier niveau de retraite obligatoire. En fonction de leur catégorie socio-professionnelle, les assurés sont affiliés à un <strong>régime de retraite de base </strong>(ex : régime général des salariés, régime agricole, régime des indépendants, régime des fonctionnaires, etc.).</p>. Le décret a prévu le mode de partage des points lorsque le défunt a été marié plusieurs fois. Ceux-ci sont répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Mais attention : le conjoint survivant qui choisit les « droits combinés » renonce à la réversionPension de réversion<p>Attribution, sous certaines conditions, au conjoint d'un assuré décédé (avant ou après son départ en retraite) d'une partie de sa pension de retraite. La pension de réversion est fonction des ressources du conjoint survivant dans le régime général des salariés et les régimes alignés.</p>. Si vous êtes remarié ou âgé de moins 55 ans, vous n’avez pas le droit à la réversion et vous pouvez alors choisir les droits combinés sans avoir à peser le pour et le contre.
Cependant, si vous avez le choix, il faudra évaluer si le total des points Ava acquis par votre conjoint décédé vous offre un montant plus intéressant que celui de la pension de réversion, égale à 54 % de la retraite à laquelle il aurait eu droit. Notez que les droits combinés sont versés au moment de la liquidation de vos droits, contrairement à la pension de réversion dont vous bénéficiez immédiatement.
Un accès élargi à la pension minimale de retraite
Un 2e décret a permis aux exploitants agricoles de bénéficier d'une autre mesure de la réforme de 2014 : un accès élargi à la pensionPension de retraite<p>Somme versée périodiquement à un assuré après la liquidation de sa retraite, après cessation totale ou partielle de l'activité professionnelle.</p> minimale de retraite. Celle-ci a notamment concerné les agriculteurs à carrière partielle et leurs conjoints.
Auparavant, il fallait avoir cotisé pendant 17,5 ans pour en bénéficier. Cette durée minimale a été supprimée pour les liquidationsLiquidation de la retraite<p>Lorsqu'un assuré souhaite partir à la retraite, il doit demander la liquidation de ses droits, c'est-à-dire faire valoir ses droits pour déclencher la mise en paiement de sa pension de retraite.</p> postérieures au 1er février 2014.
De plus, le niveau de cette pension minimale a été élevé à 75 % du Smic, grâce à une allocation supplémentaire.
Aménagement du calcul de la réversion
La réversion tient désormais compte, et de façon rétroactive, de l'ensemble des points de retraite complémentaire de l'exploitant – alors que des restrictions existaient auparavant.
Un 3e décret a adapté ces mesures à l'outre-mer.
Règles d'affiliation à la MSA assouplies
La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (Laaaf) du 13 octobre 2014 et ses décrets d’application du 18 mars 2015 ont facilité les conditions d’affiliation des agriculteurs à la Mutualité sociale agricole (MSA).
Avant cette réforme, pour être affilié, il fallait soit cultiver une surface minimale, soit travailler au moins 1 200 heures sur l’exploitation. La réforme a assoupli la condition de surface, désormais appelée « Surface minimale d’assujettissement » (SMA), en incluant les activités de transformation, de conditionnement, de commercialisation et d’hébergement rural. Une 3e condition alternative d’affiliation a été ajoutée : les agriculteurs dont l’activité a généré dans l’année un revenu d’au moins 800 fois le Smic horaire (soit 9 320 € en 2024) peuvent s’affilier.
Les agriculteurs dont l’activité ne remplissait aucune de ces conditions pouvaient être soumis à l’obligation de verser une cotisationCotisation retraite<p>Somme prélevée sur les salaires et/ou les revenus professionnels afin de financer les retraites.</p> de 16 % de leur revenu à la MSA. C’est la « cotisation de solidarité », qui ne donnait droit à aucun avantage retraite (ni à l’assurance maladie des agriculteurs). Dès lors qu’un agriculteur exploitait une surface entre 1/4 et 1 SMA, ou y travaillait entre 150 et 1 200 heures, il devait la verser. Avec la réforme, l'ensemble des cotisations et des contributions sociales est désormais calculé en fonction de la durée d'assujettissement en qualité de cotisant de solidarité.
La réforme, en changeant le mode de calcul de la surface minimale, et en ajoutant la condition de revenu de 800 fois le Smic horaire, a permis à certains cotisants de solidarité d’accéder au statut d’affilié. Cela signifie qu’ils versent, depuis, davantage de cotisations, mais bénéficient en retour de droits à la retraite et à l’assurance maladie.
Niveau des pensions : un coup de pouce pour les petites retraites
Au 31 décembre 2021, la pension mensuelle moyenne des retraités non-salariés agricoles était de 788 € bruts et 1 138 € bruts pour les anciens salariés agricoles, alors que la pension moyenne de droit direct tous régimes confondus était de 1 509 € bruts mensuels fin 2020.
Plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de garantir une pension de retraite minimale plus élevée pour les agriculteurs.
Les lois Chassaigne du 3 juillet 2020 et du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisationRevalorisation<p>1. Augmentation du montant des pensions de retraite, calculée en fonction de l'augmentation des prix.<br />
2. Réévaluation de la valeur des salaires des années précédentes, en fonction de l'évolution des prix, pour calculer le salaire annuel moyen servant de référence au calcul des pensions de retraite.</p> des pensions de retraite agricoles ont ainsi rehaussé à 85 % du SMIC net agricole (contre 75 % auparavant) la pension minimale agricole pour :
- les chefs d’exploitation agricole ayant une carrière complète, à partir des pensions versées en novembre 2021 ;
- les conjoints collaborateurs qui bénéficient d’une retraite à taux plein, à partir de janvier 2022 ;
- les aides familiaux (frères, sœurs, enfants) des exploitants agricoles qui bénéficient d’une retraite à taux plein, à partir de janvier 2022.
À compter du 1er septembre 2023, les nouveaux retraités salariés et non-salariés agricoles bénéficieront d’une pension minimale garantie d’au moins 85 % du SMIC, comme tous les retraités justifiant d’une carrière complète cotisée à temps plein au Smic.
En plus de ces pensions minimales, la loi du 13 février 2023 a prévu que la retraite des non-salariés agricoles devra être calculée sur la base des 25 meilleures années à partir du 1er janvier 2026, et non plus sur l’intégralité de la carrière comme c’est le cas actuellement.
En savoir plus sur la retraite de base des exploitants agricoles.
Les agriculteurs et la réforme de 2023
La réforme des retraites de 2023 qui entrera en grande partie en vigueur le 1er septembre 2023, apporte des changements qui auront des conséquences sur les retraites des agriculteurs :
- Le report progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961 ;
- L’accélération de l’allongement de la durée de cotisation prévue par la loi dite « Touraine » pour atteindre 43 ans (172 trimestres) d’ici à 2027 ;
- Le développement du dispositif de carrières longues avec des départs anticipés à la retraite à partir de 58 ans pour ceux qui ont démarré avant 16 ans, à partir de 60 ans pour ceux qui ont travaillé entre 16 et 18 ans, à partir de 62 ans pour ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans, et à partir de 63 ans pour ceux qui ont travaillé entre 20 et 21 ans ;
- L’acquisition de nouveaux droits à la retraite après avoir liquidé une première pension grâce au cumul emploi-retraite.
les retraites des agriculteurs, ce que les dernières réformes ont changé
Les conjoints et aidants familiaux peuvent bénéficier de points gratuits de retraite complémentaire pendant au maximum 17 ans et 66 points par an (un bonus sur la pension de 30 € par mois en moyenne).
En cas de décès d’un agriculteur, son conjoint survivant, à condition de renoncer à la réversion, peut ajouter des « droits combinés » (points de retraite complémentaire du défunt).
La retraite minimale des agriculteurs a été portée à 85 % du Smic net.
L’affiliation à la MSA a été facilitée par une prise en compte plus large de la condition de surface. Une nouvelle condition d’affiliation à la MSA a été ajoutée : la déclaration d’un revenu d’activité d’au moins 800 fois le Smic horaire brut (9 320 €).
Laissez nous votre avis !
A la une
Les plus lus
A découvrir aussi