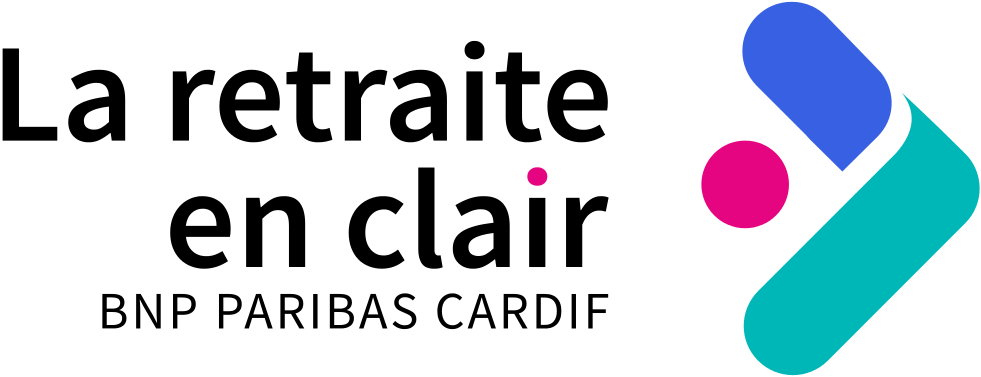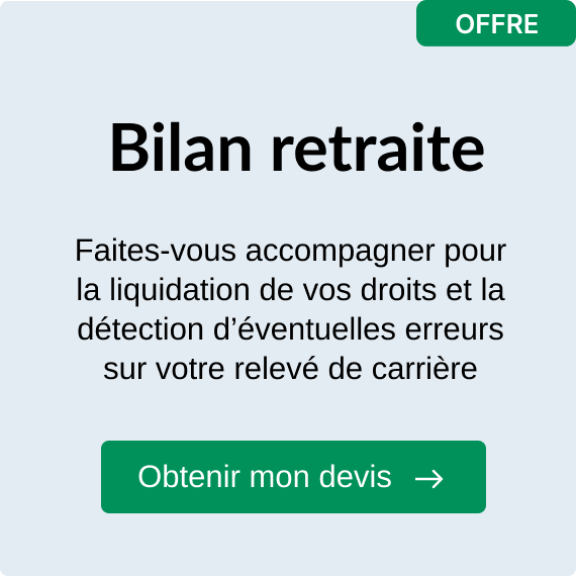La retraite des parlementaires
Députés et sénateurs ont longtemps bénéficié de régimes spéciaux très avantageux. Une 1re réforme, en 2010, les a rapprochés du régime des fonctionnaires. Depuis le 1er janvier 2018, le régime des députés a finalement été aligné sur celui de la fonction publique, tandis que les sénateurs conservent, pour le moment, leurs propres règles.
Les différents régimes et cotisations des parlementaires
Deux régimes autonomes
Les députés sont affiliés d'office au régime de retraite des députés de l'Assemblée nationale, créé par la résolution du 23 décembre 1904.
Les sénateurs sont affiliés d'office à la Caisse autonome de retraite des anciens sénateurs, créée par la résolution du 28 janvier 1905.
Les 2 régimes ont été réformés en 2010. La durée d'assurance pour une retraite complète passe notamment progressivement de 166 à 172 trimestres suivant les générations, comme dans les autres régimes. Mais ces durées sont en partie théoriques.
Enfin, le régime des députés a été aligné sur celui des fonctionnaires au 1er janvier 2018. Les droits acquis précédemment restent cependant acquis et calculés de la même façon. Le fonctionnement précis du régime a été publié sur le site de l'Assemblée nationale.
Une particularité en partie supprimée : la double cotisation
Avant 2010, les parlementaires pouvaient choisir de verser une double cotisation, qui augmentait à la fois le montant de leur pension et le nombre de leurs annuités. La double cotisation était possible pendant 15 ans, ils pouvaient ensuite cotiser 50 % de plus que la normale pendant 5 autres années. Ils pouvaient ainsi atteindre une carrière complète en 23 ans (au lieu de 40,5 ans). La réforme de 2010 a modifié les 2 régimes.
Les députés et les sénateurs ne peuvent plus verser la double cotisation depuis le 1er janvier 2018.
En ce qui concerne les députés, jusqu'au 31 décembre 2017, ils pouvaient encore surcotiser, mais de moins en moins : 50 % de plus pendant les 10 premières années (les 2 premiers mandats), 33 % les 5 années suivantes, et 25 % pendant le reste de la carrière. Ils atteignaient ainsi leur durée d'assurance complète en 31 ans environ (une durée qui aurait atteint 33 ans avec l'allongement de la durée de cotisation).
En ce qui concerne les sénateurs, un régime de retraite complémentaire par points a été créé en compensation. La cotisation est égale à celle du régime de base.
Le montant des cotisations retraites des parlementaires
Depuis juillet 2022, le montant brut mensuel de l’indemnité parlementaire (députés et sénateurs) est de 7 493,30 €. Les députés cotisent sur ce montant pour leur retraite à hauteur de 10,85 % ce qui représente environ 813 € par mois. Les sénateurs cotisent sur ce montant à hauteur de 15 %, ce qui représente environ 1 124 € par mois. Ces derniers s’acquittent aussi d’une cotisation à la Caisse des retraites des anciens sénateurs et au régime complémentaire, d’un montant de 1 157,82 €.
.
Le départ à la retraite
À quel âge les sénateurs et les députés peuvent-il prendre leur retraite ?
Seuls les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent décider de modifier le régime de retraite des députés et celui des sénateurs, qui demeurent des régimes autonomes. En pratique, les parlementaires se sont déjà alignés sur l’âge de départ des Français, en passant de 60 à 62 ans lors de la réforme de 2010. Avec la réforme de 2023 qui repousse l’âge de départ de 62 à 64 ans, les 2 Assemblées ont exprimé leur volonté de s’appliquer à elles-mêmes les nouvelles mesures qui concerneront la grande majorité des Français.
Dans les faits, les députés demandent plutôt la liquidation de leur retraite vers 65 ans et les sénateurs vers 70 ans.
Calcul de la pension de retraite
Les services du Sénat ne communiquent pas sur le mode de calcul de la retraite des sénateurs. En 2023, la pension mensuelle nette d’un sénateur s’élevait à 3 391 €, d’après une enquête de Médiapart fondé sur une note du bureau du Sénat.
Selon une étude de l’association Sauvegarde Retraites, publiée en janvier 2017, si le sénateur liquide sa retraite à 62 ans, chaque euro cotisé rapporte 6 € de pension (contre 1,5 € dans les régimes de droit commun). Selon la même étude, un sénateur touche 2,94 % de l’indemnité de base à la retraite. En 2023, l’indemnité de base est de 7 493,30 €, ce qui représente donc 220,30 € par mois pour une annuité acquise.
La retraite des députés est mieux connue. Depuis le 1er janvier 2018, le mode de calcul de leur retraite a été entièrement revu. Il se distingue de celui des fonctionnaires : la pension est calculée non pas sur le traitement des 6 derniers mois, mais sur la base de l'ensemble des indemnités perçues et soumises à cotisation. Pour chaque année passée à l'Assemblée nationale, on retient un pourcentage des indemnités versées. Ce pourcentage décline progressivement, en fonction de l'année de départ à la retraite, de 2,11 % en 2008 à 1,96 % en 2023.
En 2023, le montant net de la pension d’un député au bout de 5 ans de mandat s’établit, depuis la réforme des retraites, à 684,38 € nets, selon le site de l’Assemblée nationale.
La réversion
La réversion pour les sénateurs
Le conjoint du sénateur disparu a droit à une pension de réversion, qui s'élève depuis la réforme de 2010 à 60 % de la pension que percevait le défunt. Il n’y a aucun plafond ni conditions de ressources.
Les orphelins de moins de 21 ans ont aussi droit à 10 % de la pension.
Les règles précises, depuis 2010, se sont en principe rapprochées de celles appliquées par les fonctionnaires, mais elles ne sont pas accessibles publiquement.
La réversion pour les députés
La réversion des députés fonctionnait de façon analogue à celle des sénateurs jusqu'au 31 décembre 2017. Depuis le 1er janvier 2018, elle est alignée sur celle des fonctionnaires. Le conjoint d'un député disparu perçoit 50 % de la pension du défunt, sans condition d'âge ni de ressources. Il doit avoir été marié au moins 4 ans au député, ou au moins 1 an (au lieu de 2 pour les fonctionnaires) avant son départ en retraite, ou avoir eu au moins 1 enfant avec lui.
Ce qu'il faut retenir sur la retraite des parlementaires
Les députés et les sénateurs sont affiliés d'office à des régimes spéciaux (créés respectivement en 1904 et en 1905), qui fonctionnent de manière autonomes.
La double cotisation, qui augmentait le montant de la pension et le nombre d'annuités, a été partiellement supprimée en 2010.
Les députés versent une cotisation retraite d’environ 813 € par mois (10,85 %) sur leur indemnité parlementaire. Les sénateurs s’acquittent d’une cotisation retraite d’environ 1 124 € par mois (15 %) pour leur retraite de base, et 1 157,82 € pour leur retraite complémentaire (en 2023).
L'âge de départ à la retraite est de 62 ans et devrait passer à 64 ans, sous réserve que les bureaux des 2 assemblées décident effectivement de s’aligner sur la réforme des retraite 2023. En pratique, députés et sénateurs liquident déjà leur pension de retraite après 65 ans.
Sur le montant des pensions (retraite et réversion) :
- le régime des députés est aligné sur celui des fonctionnaires depuis le 1er janvier 2018 ;
- la pension mensuelle nette d'un sénateur s'élève en moyenne (en 2023) à 3 391 € et la pension de réversion est égale à 60 % de celle du défunt.
Laissez nous votre avis !
A la une
Les plus lus
A découvrir aussi